Pourquoi écrire, musicologue ?
Dialogue de l’écoute et de l’esprit
Matthieu GuillotDOI : https://dx.doi.org/10.56698/filigrane.93
Résumés
Résumé
Ce texte développe une réflexion sur le rôle et la nécessité actuels de la musicologie, vue comme pratique explicative à repenser d’un besoin crucial de l’œuvre musicale, elle-même considérée comme puissance transformatrice d’une existence de plus en plus en proie à l’appauvrissement culturel et spirituel. Il décrit aussi les conditions de renouvellement d’une musicologie appelée à venir au secours d’une « reprise de conscience » collective. On suggère finalement d’emprunter la voie d’une écoute particulière qui serait en prise directe avec les attentes esthétiques à combler : revenir à une certaine intériorité.
Abstract
This text develops a reflection on the current role and necessity of musicology, seen as an explicatory practice rethinking from a crucial need within the musical work, itself considered as the transforming power of an existence more and more prey to cultural and spiritual impoverishment. It also describes the prerequisites for renewal of a musicology called upon to foster collective “re-awakening”. In conclusion, we suggest opting for a particular way of listening, in direct link with the aesthetic expectations to be met: coming back to a certain interiority.
Traduction Jeffrey Grice
Texte intégral
« L’assombrissement du monde n’atteint jamais la lumière de l’Etre ».
Martin Heidegger, « L’expérience de la pensée », 1947
« Mais qu’en est-il alors de la culture – et, avec elle, de l’humanité de l’homme ? »
Michel Henry, La barbarie, 1987
Etat d’une situation présente
1Dans un récent ouvrage qui « en appelle aux artistes vivants contre le spectacle, et à la liberté individuelle contre la fascination collective », Philippe Dagen, spécialiste de l’art contemporain, évoque, désabusé, la perte de la « nécessité » des livres. Il a cette phrase directe et sans appel : « Il n’y a aucune raison d’écrire. Il n’y a plus aucune bonne raison d’écrire »1. Le ton est grave, l’affirmation ouvertement désespérante. A notre tour, nous sommes tenté de souscrire pleinement à cette opinion, car on ne saurait porter plus juste jugement sur l’état actuel de la pensée – nous n’osons pas mettre de majuscule… –, ou de l’absence de pensée, vu la situation de délabrement dans laquelle s’enfonce la culture. Pourquoi écrire encore en effet, et pour qui écrire, si le destin de cette écriture est de demeurer définitivement lettre morte ? Pourquoi encombrer davantage les rayons de bibliothèques désertées, que personne n’arpenterait plus ? Pour quelle hypothétique postérité déclinante qui, séduite par d’autres sirènes, se prépare déjà à décliner l’offre ? Nous songeons à cette intuition prophétique de Jean Guitton (datée de 1955) qui voyait venir – aux sens propre et figuré ! – l’image télévisuelle et ses conséquences humaines néfastes : « Notre civilisation va sans doute cesser de lire pour entendre et pour voir ». Et plus loin, ce vœu formulé, presque avec crainte (ne plus lire, l’idée fait trembler) : « J’espère que le livre subsistera, tant qu’il y aura en ce monde des pensées à transmettre »2. Or un demi-siècle plus tard, le problème de notre société concerne moins le livre, qui subsiste malgré tout (mais pour combien de temps encore, et dans quel état de l’édition ?), que la pensée elle-même, ou les pensées, ainsi que leur transmission et leur partage. Mais aussi, la nécessité d’écrire ne rejoint pas forcément l’utilité de cette écriture. Ecrire, pour celui qui pratique honnêtement cette activité, serait non seulement un mode de vie, mais aussi une forme de vie. Celle-ci paraît d’ailleurs aujourd’hui une très ancienne forme, tant l’écriture (ou ce qui en tient lieu) s’est ridiculisée en tombant dans les plus bas travers commerciaux. En la banalisant à l’extrême, on désertifie l’écriture, on désécrit. Emil Cioran le notait avec dépit, George Steiner l’a souvent constaté et répété : on écrit beaucoup trop, livres ou études, sans aucune nécessité impérieuse, sans raison valable.
Conscience et interrogations
2Sur le grand mal de la culture ou les motifs de l’inculture, diagnostics et pronostics s’accumulent. Mais en lieu et place des nombreux livres abordant le problème, qui sont un peu comme des armes à blanc, inoffensifs, il y faudrait donc au moins des émissions télévisuelles aux heures de grande écoute, dont les penseurs s’empareraient unanimement dans un coup de force pour faire passer efficacement leurs messages d’alerte ou de mise en garde, en autant de coups de semonce, et ainsi les diffuser bien plus largement à leurs concitoyens. En vérité, leurs livres sont comme (déjà) brûlés, car tout se passe comme s’ils subissaient le sort imaginé au siècle dernier par Ray Bradbury dans son célèbre Fahrenheit 451 : traqués, soumis à la vindicte, confisqués, détruits afin que nul ne les lise. Seuls des îlots d’irréductibles les protègent encore de cette furie. Mise à mal, rudoyée, pourchassée par une impensée haineuse et glorieuse qui domine et décide tout, la pensée doit quant à elle trouver sa place, de plus en plus exiguë, dans ce paysage de désolation. Elle ressemble maintenant à un refuge pour ceux qui ne se reconnaissent pas à l’extérieur de lui, refuge assailli de toutes parts et qui endure les coups de bélier répétés de la société du divertissement érigé en modèle de vie universel.
3La pensée est-elle en ce sens une action ? Elle s’apparente du moins à un acte réfléchi, dont la finalité plus ou moins avouée serait d’infléchir l’état d’une situation, actuellement très insatisfaisante. Celle-ci suscite a priori peu l’enthousiasme et l’appétit chez le musicologue de s’adonner, malgré tout, à une tâche d’apparence bien secondaire en l’état actuel des choses : questionner l’œuvre musicale, encore et toujours. Ou, à l’inverse, l’environnement humain ou, c’est selon, in-humain, nous pousse à nous plonger à corps perdu dans la futilité qu’il ne nous reste plus, afin de ne pas sombrer corps et âmes dans la désespérance du temps présent. Cette futilité qui ne fait pas de nous des marchands du temple – ceux-là même qui ne perdent pas le « sens boutiquier », selon une exquise formule d’Edgard Varèse3, mais peut-être (forçons un peu le trait) des sortes de « templiers » qui défendraient, par la fidélité en leurs principes, la force de leur plume et de leur foi inébranlable, ce que nous croyons vital – la puissance transformatrice de l’œuvre musicale – pour ne pas avoir à redire, dans un contexte nouveau, cette phrase de Vercors du Silence de la mer : « ils éteindront la flamme tout à fait ! » – à savoir l’esprit ne sera plus éclairé par cette lumière ; l’esprit ne sera plus nourri de musique, n’ayant plus rien à écouter.
4Philosophiquement, le Heidegger des Holzwege, on le sait, a construit l’une de ses fameuses réflexions à partir du poète Friedrich Hölderlin et de son élégie « Brot und Wein », en citant la phrase « …und wozu Dichter in dürftiger Zeit ? » : « …et pourquoi des poètes en temps de détresse ? » Paraphrasons, détournons le poète et demandons-nous à notre tour : pourquoi des musicologues en ces temps de tourmente ? A quoi bon un musicologue aujourd’hui, et à quoi sert-il ? Parallèlement, détournons encore l’historique question pourquoi écrire, poète ? et reformulons-la : pourquoi écrire, musicologue ? Interrogation qui sous-entend : quel est ton lecteur, et qui se soucie de toi ?
Culture et musicologie
5Avec une heureuse conviction, Joëlle Caullier en appelle à une musicologie englobante, à une musicologie sans frontières, pourrions-nous dire, en tant qu’elle lève les barrières entre disciplines, les unes devant se nourrir des autres, sans restriction, dans une circulation mutuelle des connaissances et des idées4. Mais allons plus loin : dans le contexte actuel désormais, l’action artistique, l’action musicologique sont aussi des actions humanitaires, en ce qu’elles guérissent les âmes, volent au secours des esprits affamés de culture, ou qui ne peuvent être sauvés que par elle. En ce qu’elles veulent empêcher à tout prix la paupérisation culturelle et spirituelle de l’époque. L’ultime salut se tient donc dans une culture artistique qui puisse sauver l’esprit d’une mort certaine, condamné à l’avance à une mort lente par l’abrutissement général, national et trans-national. En effet, société du divertissement et société de consommation sont un seul et même régime dictatorial ; elles imposent leurs apparatchiks, leurs lois, leurs pratiques claniques et opaques. Elles ne vendent que du vent. Mais ce vent mauvais s’engouffre partout et rend fou. « L’encens s’élève, mais vers les athlètes et les pop stars, les assoiffés de fric et les rois du crime »5.
6Comme le constate avec dépit P. Sloterdijk, la musique populaire (ou variété [ !] internationale) fait partie de ces « langues mondiales » qui se sont « imposées à la veille de l’an 2000 »6. A partir du moment où l’on observe cette donnée, quel pouvoir aurions-nous de trouver une parade à cet envahisseur, qui détient lui-même les pleins pouvoirs ? Du moins, comment endiguer le flot incessant de ses déferlantes ? Mais tout concourt à dire qu’il est décidemment déjà trop tard, que le mal est fait : ne soyons ni sourds ni aveugles, le poison s’est propagé sans que nous détenions encore l’antidote miracle. Il a insensibilisé les êtres, au point qu’ils semblent porter des cuirasses, des carapaces, et qu’épaissis, plus rien ne les touche. Car on leur ôte ainsi toute capacité à écouter la véritable musique ; on les dé-musicalise radicalement. Ceux-là deviennent alors des infirmes, au sens où l’entendait Cioran : « Quelqu’un qui n’est pas sensible à la musique souffre d’une infirmité énorme »7. Certes, autopsier cette situation dramatique pour en cerner de près les motifs demeure toujours possible (ainsi Sloterdijk analyse-t-il finement et savamment le charme nocif de la voix pop/rock/variété qui ensorcelle le commun des auditeurs en leur « Moi archaïque »8). Mais la satisfaction intellectuelle qu’on en tire est très mince face aux bas-fonds de la réalité. Ainsi, dans un texte marquant, Bernard Stiegler a bien analysé la situation de notre société scindée en deux, une large part de la population étant « entièrement soumise au conditionnement esthétique » d’un marketing « devenu hégémonique », qui la plonge dans une « misère symbolique faite d’humiliation et d’offense », tandis que l’autre partie, privilégiée, « celle qui expérimente encore », aurait « fait son deuil de la perte de ceux qui ont sombré dans ce conditionnement ». Si celui-ci n’est pas surmonté, il risque de conduire « au dégoût généralisé »9. N’est-il pas déjà atteint ?
7A cette vision sombre et lucide, on peut toujours opposer un autre angle d’attaque, qui consiste à insister sur ce qui passe inaperçu aux yeux du plus grand nombre, mais n’en continue pas moins d’exister isolément. Ainsi Bernard Sichère souligne-t-il à juste titre que, même bafoués, remisés, la philosophie et le poème « font actes de résistance » mobilisée rien moins que par « la volonté de vivre », que la pensée n’est pas morte mais désormais « rare et clandestine » parce qu’elle « n’est pas spectaculaire », à l’instar du poème qui « circule de main en main, loin des centres de pouvoir »10. Il ne nous resterait donc plus qu’à imaginer puis à développer une esthétique de la résistance, et mieux encore, une esthétique de l’offensive, afin de s’attaquer, en actes aussi bien qu’en pensées, aux racines du mal qui ronge une société terriblement ramollie. Car une action de déshumanisation en profondeur y est à l’œuvre – ce que le philosophe Michel Henry appelait les « pratiques de la barbarie »11. Face à ces offenses de toutes sortes qui nous sont faites, développons une esthétique contre-offensante ! Totalement inoffensive, donc inopérante dans un contexte hautement hostile, la musicologie doit basculer vers une pensée-activité offensive. Tel est le défi auquel elle ne peut guère manquer d’échapper – du moins si elle tient effectivement à participer au concert de la nation, concorde ou discorde. Reprenons donc à notre compte l’avis énoncé avec raison par Jean-Claude Guillebaud : « Au fond, il est tout simplement urgent de ne pas consentir »12. Pas de consensus possible en effet ; visons alors la dissension avec l’avis général et généralisé, et osons le contre-courant.
L’amnésie anesthésique
8On a pu affirmer, voici quelques années déjà, que nous vivons peut-être « l’époque de la post-sensibilité », c’est-à-dire caractérisée par un « oubli de la sensibilité »13. Or un constat s’impose aujourd’hui qui abonde dans ce sens : désormais, la sphère de l’audible (ou la seule apparition du son) dans laquelle nous évoluons quotidiennement n’est plus dans sa majeure partie manifestation d’un invisible. Elle n’est que la moitié minoritaire et amoindrie d’un visible-spectacle jeté en pâture, qui doit sauter aux yeux en accaparant le regard, afin de détourner ou contourner le sonore. Il reviendrait donc aux musicologues de désolidariser rapidement ce maudit couple contre-nature afin que l’audible retrouve sa vraie place comme sa vraie fonction, qui sont celles d’une éternelle invisibilité, garante de l’imaginaire illimité. Même si un Igor Stravinsky affirmait que la musique se voit (affirmation à remettre dans son contexte particulier), le visible tel que nous le connaissons de nos jours n’est que distraction voulue, voire oppression de l’audible, il est entrave et prise en otage du son, servile valet d’un maître féroce. C’est pourquoi l’immense majorité des produits de la variété opère un bouleversement complet de la sensibilité ; elle la pervertit, voire l’invertit, la faisant passer d’un état de réception normal à un état totalement antiréceptif, fermé, fortement anesthésié. Il en résulte que du sentir, de la sensation au sens noble (H. Maldiney), on est passé au seul sensationnel, au sens primaire et vulgaire, à ce qui « fait sensation » mais dans l’oubli de toute sensibilité, dans une sensitivité grossière, immédiate, de courte durée et qui pare au plus pressé en faisant l’impasse complète sur le temps du cheminement esthétique. Or, évidence aujourd’hui oubliée qu’il faut à nouveau révéler, la musique est trace de l’invisible par essence, trace de l’intériorité renvoyant aux caches secrètes de la gestation artistique. Elle « lutte, travaille au sens fort […] pour donner trace ou pour faire signe, dans l’audible, d’un geste sonore qui excède l’audible », écrivait Lyotard14. Visibilité d’un invisible en peinture abstraite, tel est également ce que Michel Henry s’est proposé d’analyser brillamment dans son ouvrage sur W. Kandinsky15.
Le musicologue dans la société
9Dans un tel contexte, notre activité de musicologue peut sembler bien dérisoire ; mais alors tout est dérisoire, y compris « vivre en musicologue », qui est tourné en dérision par le contexte même. Faudrait-il donc passer de l’activité habituelle (penser, écrire) à l’action nouvelle et à la réaction (rentrer dans la mêlée ? S’occuper en fin de compte de ce qui nous regarde ? Accéder à certaines décisions d’importance ?) ? Sans quoi, sommes-nous menacés d’extinction ? Le musicologue mène-t-il déjà un combat d’arrière-garde ? Forme-t-il le dernier carré ? Est-il de cette garde qui meurt mais ne se rend pas ? Qui a déjà capitulé sans opposer de résistance ? Ou sinon, comment peut-il mener la contre-offensive ? Il faudrait pour répondre se demander d’abord quels sont l’impact et l’efficacité du musicologique sur le culturel au sens large. Il ne s’agit pas de devenir utilitaire à une société qui nous utiliserait comme bon lui semble, c’est-à-dire probablement mal. Il nous revient plutôt de lui montrer, presque preuves à l’appui, que le musicologue possède une utilité propre : si écrire et parler sur la musique relève d’une obscure nécessité, celle-ci est tout sauf du non-sens – une nécessité sensée. Pourtant, son activité demeure en marge et fait du musicologue un marginal notoire. Pour la société actuelle, le musicologue est à la fois invisible et inaudible, on ne le voit pas, on ne l’entend pas. Il n’existe donc pas. Tel est également pour lui le sens, plus sombre qu’il ne faudrait, de cet invisible auquel le présent volume a choisi de se consacrer. Or l’« invisible musicologue », quelles traces laisse-t-il dans la société ? – c’est la question cruciale. Aussi a-t-il besoin de gagner en visibilité, donc – sans jeu de mots – en lisibilité et en audibilité. Il y a nécessité impérative qu’il soit lu et entendu pour revendiquer le droit à exister au sein de la communauté culturelle. Lu ? Que les éditeurs prennent leur responsabilité en faisant leur travail, et cessent d’invoquer de fausses raisons (économiquement régies) pour se soustraire à leur devoir. Entendu ? Mais alors, que le musicologue se décide aussi à écrire dans le souci d’être compris. Qu’il porte sa parole à ceux qui ont besoin de l’entendre, et qui ne la soupçonnent même pas ; c’est aussi en cela que le musicologue a un devoir de parole. Qu’il brise ce cercle restreint formé par ses seuls collègues et autres trop rares initiés. George Steiner, voici déjà quinze ans, brossait le portrait bien peu reluisant de l’Université et de ses déplorables travers, comme celui du « commentaire mandarin »16. Et P. Dagen n’hésite pas, en quelques lignes efficaces, à régler son compte à des pratiques intellectuelles universitaires bien peu glorieuses mais si répandues, en vogue dans l’esthétique – les références déférentes et autres congratulations intéressées17.
10La solution ultime pour le musicologue, la limite de son opposition au cours des événements, ce serait la protestation silencieuse ; ce serait décider de faire silence. G. Steiner écrivait ainsi : « Le silence est vraiment une alternative. Quand la cité éructe la sauvagerie et le mensonge, rien ne porte plus loin que le poème non écrit »18. Que, à l’instar des musiciens de l’orchestre requis en son temps par Haydn, nous fassions un à un nos adieux, nous quittions ostensiblement la scène des Humanités en la plongeant dans une ombre lugubre, pour dénoncer notre condition. Mais le remarquera-t-on vraiment ? Rien n’est moins sûr ; car qui nous regretterait ? Cette cruelle question pleine de désillusions en appelle immédiatement d’autres : qui a besoin des musicologues dans la société ? Quels services rendent-ils à celle-ci ? De quelle utilité lui sont-ils ? Car nous attendons toujours d’elle notre reconnaissance. Et si les compositeurs, les maîtres de la création, décidaient eux aussi de se joindre un temps à ce mouvement protestataire, qu’en serait-il de la situation musicale ? De l’état de la musique dans une société si prompte à la négliger ? (L’intérêt et la proximité du musicologue pour la création musicale d’aujourd’hui pourraient lui faire dire tout aussi bien : pourquoi composer, compositeur ? Car les deux situations ne sont-elles pas similaires de quelque façon, sous quelque angle commun ?)19
11Si le musicologue fait silence, décide de se taire, de ne plus prendre la plume, au lieu « d’ouvrir sa gueule » comme Pierre Bourdieu l’aurait dit, alors le terrain qu’il cèderait dans l’espace de la parole, vacant, serait immédiatement envahi par une masse de profiteurs qui l’accapareraient, nouveaux promoteurs immobiliers d’une culture en ruine. Or tout le mal que le musicologue a, c’est de maintenir son logos, de le préserver, de le faire entendre – tout comme la musique a de plus en plus de mal à se faire entendre. Ce dont il se rend ainsi compte, c’est de la précarité de cette parole – parole qui ne porte pas, « parole en l’air », flatus vocis, parole étouffée par le bruit impassible du monde, par le tintamarre abrutissant des radios et télévisions, parole qui n’est ni entendue, ni écoutée. Parole déconsidérée, ou pire, inconnue de tous ! Notre « temps de parole » serait-il déjà compté ? Si nous ne voulons pas demeurer des figurants de la culture – de pâles figures, des acteurs de second plan, de second rang – il nous reste à entreprendre ce pas en avant décisif dont pourrait dépendre le rôle que nous avons à y jouer. Il va nous falloir remettre les choses en place. Monter au créneau, décider d’un engagement. Certes il faudra de la hargne si nous voulons mettre à mal ces citadelles, ces forteresses vides de sens qui nous privent d’une liberté culturelle fondamentale. Instaurer une musicologie non de déploration, mais qui s’insurge ouvertement avec véhémence contre le sort réservé au musical, tout en créant les outils nécessaires à une riposte active : la désertification culturelle et spirituelle nous guette tous.
12Pour exister, on le sait, il faut être vu, plus que jamais. Mais que doit faire le musicologue pour être mieux et davantage entendu ? Sans doute comme l’œuvre musicale : s’ouvrir à une meilleure audibilité, afin de se soucier réellement de la portée de son message. Arrêtons-nous précisément à la musique de notre temps, qui a beaucoup pâti de son « inaudibilité » – reproches qui persistent. Un compositeur actuel comme, par exemple, Pascal Dusapin a, depuis des années, entrepris dans son écriture d’introduire davantage d’audibilité (même si d’autres circonstances extra-musicales en sont la cause) : en témoignent ses Préludes pour piano, ses récentes œuvres chorales (Granum sinapis), ou son dernier opéra, Perelà. Il faudrait encore citer les œuvres de Kaija Saariaho (telle que celle écrite pour orchestre et chœur en mémoire à Gérard Grisey) ou de Marc-André Dalbavie (comme récemment Color et The Rocks under the Water pour orchestre), qui mettent en avant tout un réseau de consonances, qui mettent en évidence toute une structuration de la lisibilité, une organisation de formes claires, décelables, par différents moyens d’orchestration et d’écriture, réintroduisent le souci d’une musique assez immédiatement abordable, bref, rétablissent le contact avec la perceptibilité, rompu depuis longtemps par d’autres esthétiques. Toutefois, en ce qui concerne l’œuvre musicale, le risque existant demeure toujours celui de l’affadissement, de la retombée dans la facilité20. Pour le compositeur, cela ne signifie pas qu’il faut être consonant avec la société, se mettre à son diapason (qui, de toute façon sonne faux), mais qu’il doit parvenir à un équilibre satisfaisant grâce à une écriture « soucieuse d’euphonie […], en quête d’une certaine harmonie, non pas d’une consonance trop sucrée, d’un hédonisme trop concerté », comme le dit Jean-Claude Risset, lui aussi préoccupé par cette question difficile21.
Ecrire en musicologue
13Davantage d’audibilité musicologique, disions-nous : en effet, le musicologue peut-il vraiment continuer à écrire comme si de rien n’était, comme si le monde n’influait en rien sur notre écriture et notre pensée ? Cela ne revient qu’à produire du texte en pure perte. Non, il est décidément un temps où celui qui écrit doit se demander : pourquoi écris-je ? Quelle(s) raison(s) me pousse(nt) à le faire ? Il doit comprendre que rien ne sert de produire un simple entassement de travaux, un bavardage de type moulin à parole qui ne cesse pas. Cela ressemble fort à une sérieuse remise en question. A maintes reprises, G. Steiner a dénoncé le délire du « raz de marée banalisant, si souvent sans nécessité, du verbiage dans les publications savantes », comme la « pléthore de hautes jacasseries personnelles »22. Dans le même temps, il a bien vu le danger de l’enfermement de l’étude et de la « fréquentation du livre à haute dose », qui frôlent la « déshumanisation » parce qu’elles éloigneraient le lecteur, le travailleur intellectuel, de la « réalité politique et sociale prégnante »23. (Mais déjà Saint-Exupéry, dans Citadelle, soulignait la vanité d’une instruction réduite à ne faire de l’homme « qu’un livre qui marche »). Nous entendons prendre en considération ces avertissements. En somme, pour se faire clairement entendre, pour que ses paroles portent, le musicologue doit rectifier ses choix, descendre de sa tour d’ivoire. Il doit, en personne, se faire entente : tendre vers une « entente cordiale » – s’entendre mutuellement avec celui à qui il s’adresse et destine son discours. Par ce biais, toucher au cœur, toucher avec sincérité le cœur de l’autre, prioritairement l’objet de ma rhétorique de conviction, par un discours qui serait à fleur de peau, voire tendrait presque au seuil des larmes (conception chère au jeune Cioran). Il s’agit donc davantage de l’instauration d’un dialogue, au lieu d’un monologue ou de concerts de soliloques, propres aux colloques de spécialistes, qui ne débouchent sur rien. Le lien était rompu avec l’interlocuteur invisible : il faut donc nouer de nouveaux liens (nous rejoignons le leitmotiv obsédant de Saint-Exupéry).
14Adapter son langage pour se réapproprier l’espace d’une pensée à partager suppose de revenir à la source de notre identité de musicologue. Quelle est-elle ? Elle ne concerne rien moins que la pensée au contact vivant de la musique. Pourquoi penser ? Et pourquoi penser en musicologue – à partir de la musique ? Parce qu’une œuvre musicale un jour nous touche, et, qu’en nous touchant, nous entendons qu’elle semble murmurer : dis-moi qui je suis. Perce mon mystère. Dès lors, il nous faut dire, dans un irrépressible besoin, cette œuvre, qui s’ignore. Il nous faut porter témoignage, en la cernant de notre commentaire. Dans sa postface à L’origine de l’œuvre d’art, texte qui concerne « l’énigme que l’art est lui-même », Martin Heidegger reconnaissait modestement, peut-être parce qu’il en mesurait l’extrême difficulté : « Loin de nous la prétention de résoudre cette énigme : il importe avant tout de la voir »24. Sans doute est-ce là notre seule capacité de musicologue lorsque l’œuvre musicale se fait énigmatique. L’entendre comme telle, comme réponse devançant des questions qui ne se sont jamais posées à nous. Notre démarche est une transmission d’expérience : nous faisons part d’une connaissance acquise, venue d’une expérience vécue, éprouvée à travers notre chair perceptive. Le propre du musicologue, c’est d’être soumis à l’interrogation de l’œuvre musicale, et quand elle le tient en haleine, il se lance dans une tentative de réponse – en somme, dans l’instauration d’un dialogue. Ce que Steiner voit à propos de « tout acte de lecture complète », c’est qu’en lui « sommeille l’idée compulsive d’écrire un livre en réponse »25. De même pour le musicologue, l’appel musical, vibration vitale qui est atteinte à l’esprit, lui intime l’ordre de se mesurer à lui, ce déchirement du sens, à l’occasion vérité assénée, désorientation et réorientation de la compréhension.
Un dialogue avec l’écoute
15Réfléchir sur la musique suppose un contact premier, originaire, prioritairement de l’ordre du sentir, d’un dialogue avec l’écoute. Aussi avons-nous besoin de mettre en jeu une musicologie du Sturm und Drang, d’une esthétique de la tempête et de l’élan – tempête des idées, élan du cœur et de la pensée – qui déploierait une nouvelle sensibilité, une nouvelle Empfindsamkeit. Ainsi se dessine une démarche éthique comme positionnement musicologique, qui peut alors engager la réflexion sous le signe de la sensibilité, terme ambigu et plurivoque jadis bien éclairé par le philosophe Louis Lavelle, qui écrivait d’elle que, fine, elle « saisit cette nuance infiniment délicate qui traduit l’essence incomparable des choses et le rapport mystérieux qu’elles ont avec nous »26. La sensibilité auditive est incontrôlable ; en cela, elle est susceptible de générer des aspects inattendus, de faire naître des potentialités enfouies en chacun. Certes les multiples sollicitations esthésiques induites par l’œuvre musicale impliquent des coordinations méthodologiques. Mais celles-ci, de leur côté, ne sont pas à bâtir dans un splendide isolement, en-dehors de l’œuvre et de son aura, c’est-à-dire dans son oubli. Car, que cache et que trahit occasionnellement le discours technique ? La technicité rationalise l’émotif, fige scrupuleusement le vivace, elle engage de l’impassibilité, une distance nécessaire parce que rassurante vis-à-vis du trouble musical qui nous déstabilise, nous serre la gorge, empêche de nous exprimer. Mais, ce faisant, elle masque par son exclusivité l’essentiel de l’expérience musicale qui, réprimé, résiste et couve toujours27. D’où une certaine nécessité musicologique de renouveler le discours esthétique sur l’œuvre musicale, contemporaine tout particulièrement, lorsqu’elle souffre de son absence. Le désir de resensibiliser le discours musicologique va de pair avec celui de développer celui-ci comme capacité de dialoguer avec l’œuvre, par l’entremise de l’écoute, figure de l’approche esthétique28. La notion de dialogue avec l’écoute requiert l’odyssée de l’auditeur à travers ses pérégrinations de musicologue, pèlerin marchant en terre inconnue, toujours en quête de découvertes et de révélations, et qui médite au long de ce pèlerinage, au contact de la substance sonore, par un va-et-vient permanent entre les divers niveaux de l’intériorité et de la sensibilité qui les fait vaciller.
La musique comme resensibilisation
16Contre l’amnésie anesthésique ambiante, la musique de notre temps doit être le porte-flambeau du retour au sensible. L’œuvre musicale issue de ce vouloir se singularise surtout par sa puissance d’ouverture à l’inconnu, conduisant l’auditeur vers des contrées sonores parfois inexplorées. C’est qu’à la soif du nouveau chez celui-ci coïncide la quête acharnée chez le compositeur de ce qui n’aurait jamais été entendu : le radicalement autre, le résolument explorateur, qui soumettent notre écoute à l’épreuve décisive de l’inouï. L’œuvre est incitation à redécouvrir l’ensemble de ses aspects audibles, les plus extrêmes, les plus cachés, les plus imaginatifs, les plus inattendus. Bousculant volontiers les consciences, ébranlant les certitudes, violentant les oreilles (Varèse) ou raffinant l’écoute (la mélodie de timbres viennoise), bref, perturbant les émotions et bouleversant la sensibilité, l’œuvre convie ainsi à une nouvelle manière d’entendre, menant progressivement àélargir le spectre de notre expérience des sons, et donc, bien plus, de notre ouverture au monde. Adorno le montrera exemplairement pour Mahler, Berg et Schoenberg, Jankélévitch pour Debussy et Satie : leurs œuvres aiguisent la sensibilité, mais aussi l’impliquent. Ouverture aumonde, et découverte de nouveaux mondes, tel est surtout le rôle primordial et crucial de l’art : manifester la présence de terres lointaines inconnues. Car « il entre en résonance avec le monde, tout monde possible en général, s’il est vrai que celui-ci est un monde sensible, prenant naissance dans la sensibilité et portée par elle »29. Varèse aimait à rappeler que Hoene Wronski, un savant du XIXe siècle, avait défini la musique comme étant la « corporification de l’intelligence qui est dans les sons ». Deux manières d’expliquer la musique ayant été considérées – soit par l’émotion (la passion), soit par l’intelligence (la raison) –, il y aurait plus profondément à parier, pour ce qui est de la musique la plus actuelle, sur une intelligence de l’émotion, ou une émotion de l’intelligence. L’intelligence de l’émotion serait la capacité de cette dernière à dépasser le choc premier pour organiser un raisonnement à partir de lui. L’émotion de l’intelligence serait l’ordre de la pensée rationnelle qui consent à une coexistence avec le trouble du désordre engendré par l’esthésie. L’essence de l’émotion, notait Lavelle, réside dans son ambiguïté, qui fait justement son intensité30.
L’œuvre musicale imperceptible, limite du son et de l’écoute
17C’est dans le cadre d’une singulière intensité que se situe le cas de l’œuvre musicale imperceptible. En elle se trouve déjà soulevées les problématiques de la limite par rapport à son audibilité, qui vire presque parfois à une abolition dans le quasi silence. Par le biais de l’imperceptible, état-limite de l’univers musical dans sa saisie immédiate, la musique se configure comme éloignement, retrait, et réticence. L’imperceptible travaille aux limites, sur la limite du son et donc de l’écoute. L’œuvre imperceptible travaille sa propre imperceptibilité, sur les seuils critiques de l’apparition/disparition, de l’émergence. L’œuvre comme telle se donne (avec restriction), se manifeste comme limite, donc comme conscience aiguë de l’expressivité d’un état sonore qui se censure dans son activité audible, fondée sur une extrême concentration, comme chez Salvatore Sciarrino et Helmut Lachenmann. Or le fait que l’oreille doive continuellement tenter de discerner ce qu’elle entend si faiblement, soit mise en demeure de pouvoir distinguer la musique, l’amène à entredistinguer des horizons sonores : pour paraphraser Bachelard, la volonté d’écouter ce qu’on n’entend (presque) pas rend alors l’ouïe perçante et pénétrante. S’il y a un refus manifeste de mettre en avant la musique, c’est bien qu’il y a le désir tout aussi manifeste de maintenir celle-ci hors de portée de l’intelligible, dans une zone malaisée à atteindre pour le sujet percevant. Réduire le sonore dans ses dimensions acoustiques revient inévitablement à amplifier son écoute ; il résulte de cette amplification la possibilité pour l’auditeur de percevoir la musique plus finement, et la surécoute lui permet d’atteindre ce qui est sous-entendu en elle en approchant les soubassements du son. Si le compositeur cherche effectivement à repousser les limites de la musique et de son audibilité, il revient à l’auditeur d’explorer les zones qu’elles bordent. Poussé à une telle extrémité, l’imperceptible devient un peu une « sensation de la limite aux limites de la sensation » tant il approche la zone critique du silence. L’imperceptible nous conduit subtilement à la limite, ou aux limites : on peut bien entendu énoncer la limite physique, sensible du son, mais aussi peut-être la limite même de la musique, voire celle de l’Etre, qui accède à un monde autre.
18Mais si le son se meurt, sa force, sa puissance phénoménale proviennent justement de sa faiblesse acoustique : il est d’autant plus prégnant qu’il paraît ténu. Abaisser ou éloigner le seuil d’audibilité ne revient donc pas toujours à faire taire la musique, comme certains le croient un peu trop facilement, ni à la refouler dans une simple absence. Mais ce geste représente manifestement un des moyens les plus probants d’atteindre une certaine qualité sonore pour elle-même, en tant que dimension musicale nouvelle offerte à l’écoute. Les œuvres de la dernière période de Luigi Nono, en ce sens, impliquent un dépassement maximal de la norme admise quant à l’abaissement de l’intensité du son. Cette modalité relève en effet chez lui d’une attitude éminemment intériorisée, poussée par une exigence intérieure qui veut contraindre le son à se dépasser lui-même, par une quête acharnée de l’Absolu du son, mais aussi du silence habité, qui lui est intimement lié dans son cas. Nono est bien celui qui veut nous faire entendre le possible. Et si sa musique réclame l’intériorité de chacun, en convoquant une dramaturgie de l’écoute (cf. son Prometeo sous-titré Tragédie de l’écoute – un véritable « drame en musique »), le compositeur italien lui-même réclame explicitement à l’auditeur le recueillement de l’écoute – un désir peut-être utopique, pour employer son propre terme. L’exploration du son menée par cette pensée compositionnelle devient l’exploration de nouveaux territoires sonores toujours plus vastes, notamment par la magie de l’électronique dont le compositeur usera abondamment, et de fait, de nouvelles frontières sonores bordant ces territoires. Il revient alors à l’auditeur de savoir faire dériver son écoute et de partir découvrir ces territoires ouverts par le compositeur, par une pensée explorative, assoiffée de découvrir l’inconnu, surtout l’inouï. L’idée de territoire n’a rien de métaphorique : la notion d’espace musical, en effet, se révèle capitale dans les grandes œuvres orchestrales et chorales de Nono. Car en filigrane réside chez lui la volonté de travailler un espace sonore complexe combinant espaces acoustiques et espaces imaginaires, qui permettent de faire circuler des résonances errantes, mais aussi de réveiller l’oreille – formule capitale pour qui veut comprendre le sens profond de sa démarche. Ce que veut obtenir Nono ici, c’est autant atteindre l’intérieur du son que toucher l’intérieur de l’écoute du sujet. L’intérêt n’est pas dans cette limite sonore historiquement atteinte, au-delà de laquelle la musique s’effondre dans le néant, mais plutôt de parvenir à une « nouvelle écoute » et à la conscience de cette écoute (réclamées par Helmut Lachenmann), ainsi que de « réveiller l’oreille et la pensée » (dixit Nono), au sens spirituel et humaniste. C’est en cela que toute musique imperceptible équivaudrait à une tragédie de l’écoute, ou une forme tragique de l’écoute, parce que celle-ci serait portée à un point tel qu’elle « rencontrerait » une volonté manifeste du compositeur, qui serait aussi de toucher la conscience humaine, et non plus seulement musicale de l’auditeur – ou précisément, de toucher la première via la seconde.
19Mais cette espèce de « dérangement » est aussi d’un autre ordre. Il suffit de voir le malaise général et la gêne provoqués dans le public par les ultimes œuvres de Nono, Feldman, et plus généralement de toute esthétique similaire31. Pourquoi ? On pourrait avancer ici une hypothèse, en insistant sur le fait que le pianississimo agit sur l’écoute de façon paradoxale, qu’il la prend pour ainsi dire à revers. L’auditeur, mis à nu en quelque sorte par cette musique génératrice d’absence qui ne sonne pas assez, ne « l’accompagne » plus, se retrouve face à lui-même, avec sa « mauvaise conscience », qui ne peut plus « s’abriter » derrière le mur de sons que le concert bâtit plus traditionnellement : il n’est dès lors pas exclu que, selon l’expression consacrée, le masque tombe. A ce stade, l’imperceptible consiste bien en une présence qui, pour ainsi dire, nous tient en respect et ne nous délivre jamais d’elle-même. La musique imperceptible étant constituée d’éléments infimes ou « sous-exprimés », son écoute est totalement happée par le sonore, dans lequel le sujet s’enfonce et se sent pris tout entier. A ce niveau presque « souterrain », l’expérience auditive se « souvient » de l’expérience ontologique et finit par la rejoindre. L’intensité d’écoute déployée comprend en effet que le peu de sonore se sublime en réalité en une intensité de présence etd’apparaître. En tant que telle, et en tant que présence vibratoire en laquelle se concentre un ensemble de tensions et d’énergies qui, dissimulées ou contenues, font se cristalliser un en deçà et un au-delà sous le son, le micropianissimo magnétise le champ sonore et, comme un aimant, attire vers lui – en même temps qu’il l’attise – un complexe de processus perceptifs, psychologiques, qui n’est pas chez l’auditeur sensation pure de l’esprit, trop vague pour être formulée, mais réaction en profondeur de son audition touchée à vif, de sa sensibilité amplement mise à contribution (répondant en quelque sorte à la sensibilité compositionnelle), c’est-à-dire en fin de compte réel retentissement. Le son ppp s’expose comme révélateur : partie à peine immergée d’un ensemble sonore potentiellement plus vaste, il en révèle la profondeur qui, si elle se fait plus ou moins jour, demeure cependant dissimulée. Le propre de ce son-là n’est pas de générer une profondeur (d’autres types de musique en génèrent aussi certaines), mais sa profondeur qui lui est très spécifique. Une spécificité liée d’abord à la proximité immédiate du silence, sur lequel le son semble doucement reposer, ouverture béante où s’engouffrent, se dissipent et résonnent toutes matières rêveuses et émotionnelles de l’auditeur. Liée ensuite à l’insoutenable fragilité du son qui effleure le silence, contact toujours au bord du gouffre, quête de l’insondable et ultime souffle de vie, ultime stade d’audibilité avant l’anéantissement. Face à lui, il s’agit justement que se maintienne la présence sonore ; autrement dit, il s’agit d’une certaine manière de préserver ce qui peut encore l’être.
20Dès lors, la musique imperceptible ne concerne plus seulement l’écoute ordinaire, celle qui se tourne vers l’extérieur et se répand dans l’espace physique, mais aussi et sans doute essentiellement l’écoute intérieure, ce qui signifie pratiquement que la part de sonore adressée directement à l’oreille diminue très nettement. Aussi est-ce ce que l’on nommera l’esprit ou la conscience, l’« oreille interne », qui recueille désormais l’essentiel du son au travers des effets de résonance interne. La musique imperceptible implique une perceptionenprofondeur, assimilable à un dépassement et un au-delà de l’écoute, autrement dit, à une forme supérieure de l’écoute, sa forme la plus aiguë et la plus accomplie, et finalement son stade suprême. Elle permet ainsi de revenir à une intériorisation particulière de l’expérience musicale. Il s’agit à présent d’intérioriser tout ce qui est écouté, de le conduire jusqu’à l’oreille de l’esprit pour deviner la part insonore perçue par l’écoute. Mais encore de plonger jusqu’à elle pour puiser les connaissances issues d’une écoute proprement révélatrice, en laquelle l’auditeur reconnaîtra comme l’état d’une genèse essentielle. Si « la musique creuse le ciel », comme l’écrit le poète, la musique imperceptible creuse l’écoute. Aussi, face à sa manifestation, sommes-nous assujettis à une sorte d’écoute seconde, l’équivalent d’un état second d’hypnose sonore, oreille fascinée par la « presque disparition vibratoire »…
21Peut-être parvenons-nous alors à un dépassement de l’horizon proprement sonore pour parvenir jusqu’à l’horizon de l’Etre : plus la musique s’absente, plus l’Etre « résonne » ; moins il y a de sons, plus l’horizon se dégage, et plus l’Etre se « présente ». L’Etre est à l’écoute, mais l’imperceptible serait aussi à l’écoute de l’Etre ; il serait hanté par l’Etre. La volonté, ou l’intention qui transparaîtrait dans l’imperceptible le ferait avec d’autant plus de force que la matière sonore se désincarnerait au profit justement de cette intention. L’imperceptible ne diffère plus de la rumeur de la Psyché : l’Etre est alors à l’écoute de l’Etre, il se retrouve via l’imperceptible. Il est à sa propre écoute, de l’intérieur, parce qu’il n’y aurait plus assez à percevoir à l’extérieur de lui. C’est aussi en cela qu’on aura pu parler d’une dramaturgie de l’écoute à propos de certaines œuvres marquantes (L. Nono). La musique serait ainsi pratiquement « mise entre parenthèses », qui correspondrait à un rappel à l’Etre. On pourrait alors proposer le parcours auditif suivant, évoluant très graduellement :
22Auditeur musique imperceptible
23Auditeur musique imperceptible Auditeur
24Auditeur (musique imperceptible) Auditeur
25Auditeur ( … … … … … ) Auditeur
26[commencement de l’oubli de la musique]
27Auditeur (… … … … … ) Auditeur
28Auditeur Auditeur
29[oubli total de la musique]
30L’Etre seul, sans (impression de) musique
31Ce qui reviendrait aussi à poser la question suivante : le but suprême de la musique est-il seulement de donner à entendre, ou bien, par l’entremise de l’écoute, de donner à penser ? On répondra qu’il est nécessairement les deux, ce qui s’entend donnant directement à penser (la musique finit par nous ramener à nous-mêmes). En ce cas, la finalité de l’imperceptible ne consiste-t-elle pas surtout, dans le peu entendu qu’elle laisse filtrer, à nourrir l’esprit, c’est-à-dire à toucher et faire « résonner » la conscience de l’Etre ? C’est le témoin silencieux d’une telle vie intérieure que le musicologue cherche à recueillir, à accueillir. Une intériorité en tant que trace d’invisible à retrouver, à suivre, à déchiffrer, à retranscrire enfin.
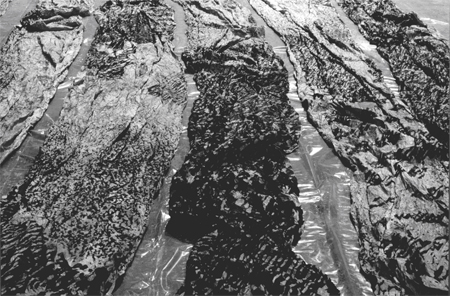
Treibgut
Dietlind Bertelsmann
Hototogisu
Nakitsuru kata wo
Nagamureba
Tada ariake no
Tsuki no nokoreru.Quand je regarde
Du côté où a chanté
Le coucou,
Il n’y plus que la lune
De l’aube !
Sanesada
in Peter Morse
Hokusai. Cent poètes
Arcueil, Anthèse, 1989
32.
Notes
1 Philippe Dagen, L’art impossible : de l’inutilité de la création dans le monde contemporain, Paris, Grasset, 2002, 4e de couverture et p. 19.
2 Jean Guitton, Journal - 1955-1964, Paris, Plon, 1968, p. 10.
3 Nous avons stigmatisé ces pratiques dans « Défaillances humaines et faillites culturelles. Le joug du “régime tsariste” » (à paraître).
4 Joëlle Caullier, « Ecrire sur la musique ? Une méditation sur la musicologie », in Filigrane n° 1, Sampzon, Editions Delatour, 2005, p. 11-31.
5 George Steiner, Maîtres et disciples, traduction Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2003, p. 184. L’auteur évoque la « célébrité, qui sature notre vie médiatique » et qui se situe aux antipodes de la renommée.
6 Peter Sloterdijk, L’heure du crime et le temps de l’œuvre d’art, traduction Olivier Mannoni, Paris, Calmann-Lévy, 2000, p. 20.
7 Emile Michel Cioran, Entretiens, Paris, Gallimard/Arcades, 1995, p. 303-304.
8 Peter Sloterdijk, Bulles. Sphères I, traduction Olivier Mannoni, Paris, Fayard, 2002 (Hachette/Pluriel, 2003), p. 536-539.
9 Bernard Stiegler, « De la misère symbolique », Le Monde, 11 octobre 2003.
10 Bernard Sichère, Il faut sauver la politique, Paris, Lignes & Manifeste, 2004, p. 19, 97-98.
11 Michel Henry, La barbarie, Paris, Grasset, 1987, chap. 6.
12 Jean-Claude Guillebaud, Le goût de l’avenir, Paris, Seuil, 2003, p. 12.
13 Cité par Laurent Cournarie et Pascal Dupond, La sensibilité, Paris, éd. Ellipses (coll. Philo), 1998, p. 152.
14 Jean-François Lyotard, « Musique, mutique », in Christine Buci-Glucksmann et Michaël Levinas (éd.), L’idée musicale, Paris, P.U.V., 1993, p. 112.
15 Michel Henry, Voir l’invisible : sur Kandinsky, Paris, François Bourin, 1988, 248 p.
16 George Steiner, Réelles présences. Les arts du sens (1989), traduction Michel R. de Pauw, Paris, Gallimard, 1991, chap. 1.
17 Op. cit., p. 159-161.
18 George Steiner, Langage et silence, traduction Lucienne Lotringer, Paris, Seuil, 1969, p. 80.
19 Ainsi dans un portrait qui lui a été consacré (film de Michel Follin, 2004), diffusé par Arte début 2005, Pascal Dusapin révèle qu’il a été fasciné par l’idée d’arrêter de créer, de poser son crayon, alors qu’il composait son dernier opéra.
20 Ainsi l’œuvre citée de K. Saariaho se rapproche-t-elle, à notre avis, bien trop par moments d’une composition de même formation de John Adams, chantre de la consonance s’il en est, Harmonium (1980). C’est dire que deux créateurs se rejoignent assez malencontreusement sans le vouloir, malgré leur provenance esthétique radicalement opposée. Mais de même chez Dalbavie dans une de ses œuvres citées ici, on retrouve des figures répétitives modales en tout point similaires à celles des Shaker Loops (1978/83)d’Adams. Voilà ce qui peut apparaître comme une source d’inquiétude et de relatif scepticisme pour le musicologue attentif à la cohérence des pensées musicales, et à l’authenticité de leurs origines.
21 In Portrait polychrome n°2 : Jean-Claude Risset, ouvrage collectif, Paris, Ina-GRM/CDMC, 2001, p. 52.
22 George Steiner, « Le crépuscule des humanités ? », in Le Débat n° 104, Paris, Gallimard, mars-avril 1999, p. 62-63.
23 George Steiner, « La haine du livre », Esprit, janvier 2005, p. 22.
24 Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962, p. 89. ; nous soulignons.
25 George Steiner, « Le lecteur peu commun » [1978], in Passions impunies, traduction Pierre-Emmanuel Dauzat et Louis Evrard, Paris, Gallimard, 1997, p. 20-21. D’où sa définition de l’intellectuel : « tout simplement, un être humain qui lit une plume à la main ». (ibid.)
26 Louis Lavelle, L’erreur de Narcisse, Paris, Grasset, 1939, chap. V (ici p. 96).
27 Pour ouvrir la parenthèse d’une autre discipline, rappelons que l’historien d’art Daniel Arasse, spécialiste de la peinture italienne, recommandait pour cerner l’œuvre le retour du regard, l’incessant retour au tableau, la vision permanente, dans une absence de méthode pré-établie. Il insistait finalement sur la primauté du regard comme enjeu même de l’étude de l’art pictural (cf. par exemple ses deux ouvrages Le détail et On n’y voit rien).
28 Ecoute qui n’exclut pas d’autres traces de l’œuvre (partition, écrits du compositeur), mais qui concentre l’essentiel de la réflexion.
29 Michel Henry, La barbarie, op. cit., p. 48.
30 Louis Lavelle, Les puissances du moi, Paris, Flammarion, 1948, p. 85.
31 Le compositeur allemand Jakob Ullmann nous confiait ainsi combien sa pièce pour orchestre de 1991, Schwarzer Sand/Schnee, avait mis l’auditoire mal à l’aise lors de sa création à Donaueschingen. Les « toussements » et autres raclements de gorge hélas bien connus en sont une déplorable conséquence, qui fait immédiatement tomber l’œuvre à plat. Il est donc fortement permis de croire que la musique imperceptible ne se destine absolument pas à la salle de concert – observation d’ailleurs faite il y a longtemps par Boulez chef d’orchestre concernant les pièces de Webern jouées en public.
Citation
Auteur
Quelques mots à propos de : Matthieu Guillot








